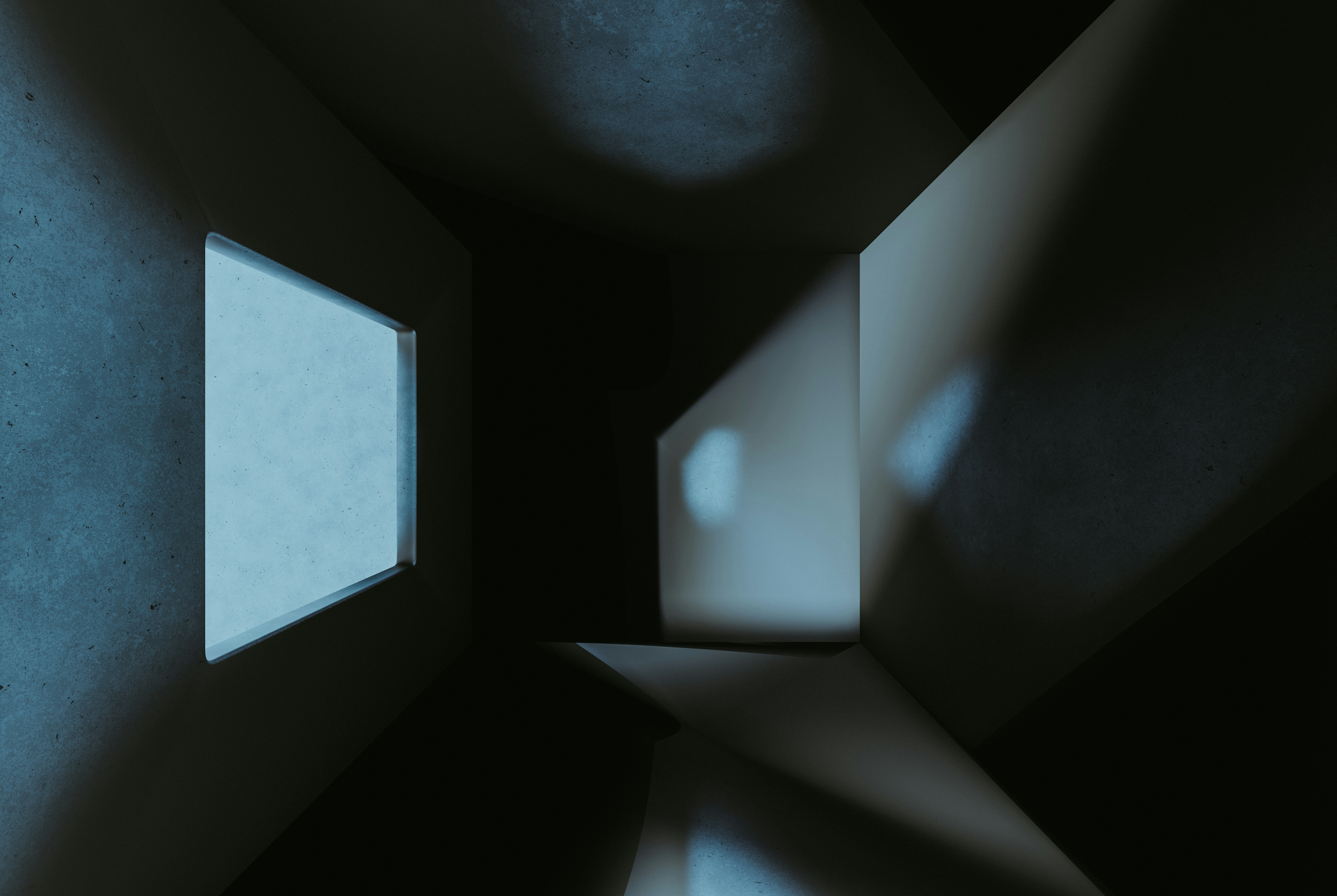Résumé
Nous partirons d’un examen des humanités médicales contemporaines pour préciser ce qu’est, en leur sein, la médecine narrative. Cette dernière s’est développée, sous l’impulsion de Rita Charon, à partir du milieu des années 2000. Ce sera l’occasion d’examiner la place du récit dans la médecine. Ce sera aussi l’occasion de souligner les liens entre la médecine narrative et certaines techniques initialement mises au point, dans l’antiquité, par les stoïciens. Ces « techniques de soi », comme les nommait Foucault, feront l’objet d’une enquête généalogique approfondie. On montrera comment Foucault s’appuie, sans toujours l’indiquer explicitement, sur des analyses issues de la phénoménologie herméneutique pour élaborer son interprétation du stoïcisme antique. Ainsi, en partant de la médecine narrative, on sera conduit à poser la question de la manière dont le rapport entre théorie et pratique a été posé dans l’histoire de la philosophie.